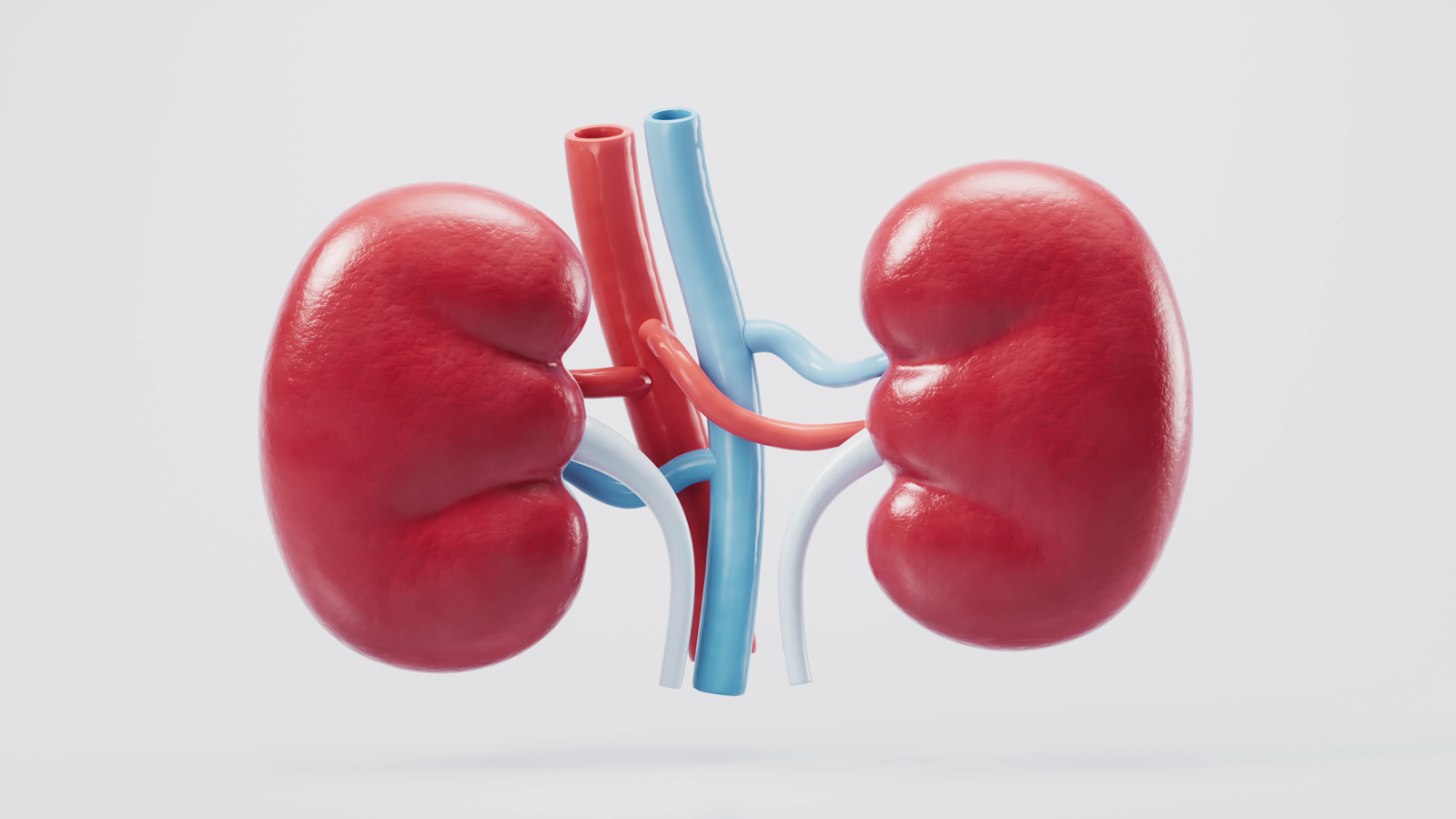- Une équipe a analysé des données se rapportant à l’insuffisance rénale grave et à la dialyse en Ontario
- Les personnes admissibles à une greffe rénale étaient moins susceptibles d’en recevoir une si elles avaient le VIH
- L’équipe demande une enquête sur les disparités de l’accès dans les programmes de transplantation d’organes
Les traitements contre le VIH (traitements antirétroviraux ou TAR) sont très efficaces et sécuritaires. Lorsqu’il est utilisé comme il se doit, le TAR réduit la quantité de VIH dans le sang jusqu’à un niveau tellement faible qu’elle est couramment qualifiée d’« indétectable ». Des études ont révélé que les personnes bénéficiant d’un tel niveau d’inhibition virale ne transmettaient pas le virus à leurs partenaires sexuel·le·s. De plus, les scientifiques prévoient de plus en plus que les personnes sous TAR vivront jusqu’à un âge bien avancé.
Le TAR ne peut toutefois résoudre tous les problèmes liés au VIH. À titre d’exemple, notons que des quantités résiduelles de virus demeurent dans les régions profondes de divers tissus (comme le cerveau), ainsi que dans diverses parties du système immunitaire (comme la rate et les ganglions lymphatiques). Il est possible que ce VIH résiduel soit partiellement responsable de l’inflammation persistante et de la suractivation du système immunitaire. Des études menées auprès de personnes séronégatives laissent croire que l’inflammation prolongée et excessive contribue à un risque accru des problèmes de santé suivants :
- maladies cardiovasculaires
- cancer
- diabète de type 2
- dépression
- affections dégénératives du cerveau
- accumulation de graisse dans le foie
- amincissement des os (ostéopénie et ostéoporose)
- taux élevés de cholestérol
- lésions rénales
- perte de tissu musculaire
- problèmes de respiration
- vieillissement prématuré du système immunitaire
Si le risque de ces problèmes s’accroît chez les personnes séronégatives, il est possible, voire très probable, que l’inflammation excessive chronique contribue également à un risque accru d’apparition de ces maladies chez les personnes séropositives, notamment en ce qui concerne les lésions rénales.
Les reins filtrent le sang et font évacuer des produits de déchets dans l’urine. Lorsque les reins subissent des dommages, leur capacité de filtration s’affaiblit. Lorsque les lésions rénales sont graves, les personnes touchées doivent souvent fréquenter une clinique d’hémodialyse pour faire filtrer leur sang par une machine. Chez certaines personnes, les lésions rénales sont tellement graves qu’une greffe de rein devient nécessaire.
Impact du VIH
Des études menées aux États-Unis et au Danemark ont révélé que le risque de lésions rénales était plus élevé chez les personnes séropositives. Même si l’accessibilité et l’utilisation répandues du TAR ont aidé à normaliser les taux de survie chez les personnes séropositives, cette population demeure à risque de subir des dommages aux reins et de présenter une insuffisance rénale qui peut entraîner une détérioration de ces organes vitaux. À l’époque actuelle, des études ont permis de constater que les personnes séropositives atteintes de lésions rénales graves nécessitant une dialyse sont plus à risque de présenter des complications et de mourir.
En Ontario
Une équipe de scientifiques travaillant dans des universités dans le sud de l’Ontario a passé en revue des bases de données se rapportant à la santé. L’Ontario est la province canadienne comptant la plus grande population, soit plus de 15 millions de personnes. Selon les estimations de cette équipe de recherche, environ 50 % de toutes les greffes d’organes effectuées au Canada ont lieu en Ontario.
L’examen des bases de données a permis à l’équipe de recenser plus de 40 000 cas de personnes atteintes de lésions rénales nécessitant l’hémodialyse. L’équipe a réparti ces personnes en deux groupes :
- 40 513 personnes séronégatives
- 173 personnes séropositives
Différences entre les deux groupes
Les personnes séropositives figurant dans cette étude étaient en moyenne plus jeunes que les personnes séronégatives (53 ans contre 68 ans). La proportion de femmes séropositives (23 %) était plus faible que celle des femmes séronégatives (39 %).
L’équipe de recherche a constaté que les personnes séropositives étaient moins susceptibles de présenter les complications suivantes :
- cancer
- maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
- diabète de type 2
- hypertension
- insuffisance cardiaque
Répartition des greffes
De prime abord, la différence entre la répartition globale des greffes de rein dans les deux groupes semblait faible pour la période à l’étude (2007 à 2020), soit 13 % chez les personnes séronégatives contre 12 % chez les personnes séropositives.
L’équipe de recherche a toutefois effectué une analyse de sensibilité des données se rapportant à un sous-groupe de 26 017 personnes ne présentant aucune maladie qui les rendait inadmissibles à une greffe de rein. Cette analyse a porté sur 25 868 personnes séronégatives et 149 personnes séropositives. L’analyse de sensibilité a révélé la répartition suivante des greffes de rein :
- personnes séronégatives : 20 %
- personnes séropositives : 13 %
Cette différence entre la répartition des greffes est significative du point de vue statistique, c’est-à-dire non attribuable au seul hasard.
Souvent, les personnes figurant sur les listes d’attente pour une greffe de rein (ou d’un autre organe) sont malades et plus à risque de mourir. Or, cette équipe de recherche a examiné les taux de mortalité prétransplantation et n’a pas constaté de différence statistiquement significative entre les deux groupes.
Après la greffe
La transplantation d’organes nécessite une chirurgie délicate de longue durée et comporte des risques. Parfois, l’organe est reconnu comme un corps étranger par l’organisme de la personne opérée. Il arrive donc que le système immunitaire de celle-ci s’attaque à l’organe greffé, lui causant des dommages ou même le détruisant. Pour minimiser les risques à cet égard, les médecins prescrivent des médicaments qui affaiblissent partiellement le système immunitaire de la personne recevant la greffe. Les médecins visent ainsi à établir un équilibre délicat entre l’inhibition immunitaire nécessaire pour protéger suffisamment le greffon tout en empêchant le risque d’infections graves d’augmenter sérieusement.
Dans la présente étude, 5 334 personnes ont reçu une greffe de rein. Il arrive parfois que le nouveau rein ne fonctionne pas correctement après la greffe et que les patient·e·s en question doivent recommencer la dialyse. Le nombre de cas de ce genre a été faible dans cette étude, soit 19 personnes séronégatives et moins de six personnes séropositives. Cette différence n’est pas significative du point de vue statistique.
Comme les personnes en attente d’une greffe d’organe sont habituellement très malades, le risque de décès persiste après la transplantation. Dans cette étude, 861 personnes séronégatives (16 %) et moins de six personnes séropositives sont décédées après avoir reçu leur greffe. Cette différence n’est pas significative non plus.
Disparité de la répartition des greffes de rein
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, cette équipe de recherche a constaté une différence significative entre la répartition des greffes de rein. Selon celle-ci, cette différence n’était pas attribuable aux facteurs suivants :
- maladies concomitantes (états préexistants tels que maladies du cœur ou du poumon, diabète, cancer, etc.)
- lieu de résidence (Grand Toronto contre ailleurs, région urbaine contre région rurale)
L’équipe de recherche a avancé les hypothèses suivantes pour expliquer pourquoi les personnes séropositives étaient moins susceptibles de recevoir une greffe de rein :
- facteurs socioéconomiques
- hésitation de la part des programmes de transplantation à considérer l’admissibilité de personnes séropositives par crainte d’interactions complexes entre les immunosuppresseurs (médicaments donnés aux greffés) et certains médicaments utilisés contre le VIH
- préoccupations selon lesquelles les personnes séropositives seraient plus à risque de perdre le rein greffé parce qu’il serait impossible d’inhiber suffisamment leur système immunitaire pour prévenir le rejet (rappelons qu’une inhibition excessive du système immunitaire pourrait augmenter le risque d’infections graves)
Comme l’équipe de recherche ne pouvait examiner que des données biomédicales provenant de bases de données ontariennes, elle ne pouvait déterminer avec certitude la source de la disparité de l’accès aux greffes de rein. L’équipe a toutefois affirmé qu’il fallait porter ce problème à l’attention des programmes de transplantation d’organes de la province.
L’équipe de recherche a cité des rapports issus de l’Europe centrale et orientale où il était question de personnes séropositives ne pouvant avoir accès à une greffe de rein. Elle a également affirmé que des « barrières substantielles » existaient encore pour les personnes séropositives vivant aux États-Unis en ce qui concerne l’accès à une greffe de rein, et ce, malgré une amélioration à cet égard depuis quelques années.
Selon l’équipe de recherche, des études menées à l’époque actuelle portent à croire que les personnes séropositives qui reçoivent une greffe de rein connaissent des taux de survie qui se comparent favorablement à ceux des personnes séronégatives.
À retenir
Les résultats de cette étude sont décevants dans la mesure où ils révèlent l’inégalité de l’accès aux greffes de rein qui défavorise les personnes séropositives vivant en Ontario. Espérons toutefois qu’ils serviront d’appel à l’action et inciteront les hôpitaux et les centres de transplantation à mieux agir pour aider les populations qu’ils servent, y compris les personnes vivant avec le VIH.
—Sean R. Hosein
Ressources
Une étude américaine révèle une carence en vitamine C chez des femmes séropositives – Nouvelles CATIE
Une alimentation riche en fruits et légumes est-elle bénéfique aux reins à la longue? – Nouvelles CATIE
Une étude d’envergure confirme l’espérance de vie quasi normale de nombreuses personnes séropositives sous TAR – TraitementActualités 249
RÉFÉRENCES :
- Hosseini-Moghaddam SM, Kang Y, Bota SE et al. Renal transplantation in HIV-positive and HIV-negative people with advanced stages of kidney disease: Equity in transplantation. Open Forum Infectious Diseases. 2024 Apr 16;11(5):ofae182.
- Hughes K, Chang J, Stadtler H et al. HIV-1 infection of the kidney: mechanisms and implications. AIDS. 2021 Mar 1;35(3):359-367.
- Chan L, Asriel B, Eaton EF et al. Potential kidney toxicity from the antiviral drug tenofovir: new indications, new formulations, and a new prodrug. Current Opinion in Nephrology and Hypertension. 2018 Mar;27(2):102-112.
- Furman D, Campisi J, Verdin E et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nature Medicine. 2019 Dec;25(12):1822-1832.
- Lopez Angel CJ, Pham EA et al. Signatures of immune dysfunction in HIV and HCV infection share features with chronic inflammation in aging and persist after viral reduction or elimination. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2021 Apr 6;118(14):e2022928118.
- Nou E, Lo J, Grinspoon SK. Inflammation, immune activation, and cardiovascular disease in HIV. AIDS. 2016 Jun 19;30(10):1495-509.
- Lubetzky M, Tantisattamo E, Molnar MZ et al. The failing kidney allograft: A review and recommendations for the care and management of a complex group of patients. American Journal of Transplantation. 2021 Sep;21(9):2937-2949.
- Baechle JJ, Chen N, Makhijani P et al. Chronic inflammation and the hallmarks of aging. Molecular Metabolism. 2023 Aug; 74:101755.
- Sayed N, Huang Y, Nguyen K et al. An inflammatory aging clock (iAge) based on deep learning tracks multimorbidity, immunosenescence, frailty and cardiovascular aging. Nature Aging. 2021 Jul; 1:598-615.
- Elizaldi SR, Hawes CE, Verma A et al. Chronic SIV-Induced neuroinflammation disrupts CCR7+ CD4+ T cell immunosurveillance in the rhesus macaque brain. Journal of Clinical Investigation. 2024 Mar 12;134(9):e175332.
- Vadaq N, Zhang Y, Vos WA et al. High-throughput proteomic analysis reveals systemic dysregulation in virally suppressed people living with HIV. JCI Insight. 2023 Jun 8;8(11):e166166.